"La culture ne s'hérite pas. Elle se conquiert." — Je suis ravie de vous accueillir sur Mon Bagage Culturel ! Pour commencer, téléchargez votre test : 50 questions pour faire le point sur vos savoirs 🙂
Heureuse de vous revoir sur Mon Bagage Culturel ! Et si vous faisiez le point sur votre culture générale ? Je vous propose un test de 50 questions, pour repérer où vous en êtes… et identifier les prochaines étapes 🔥. Téléchargez-le ici, c’est gratuit:)
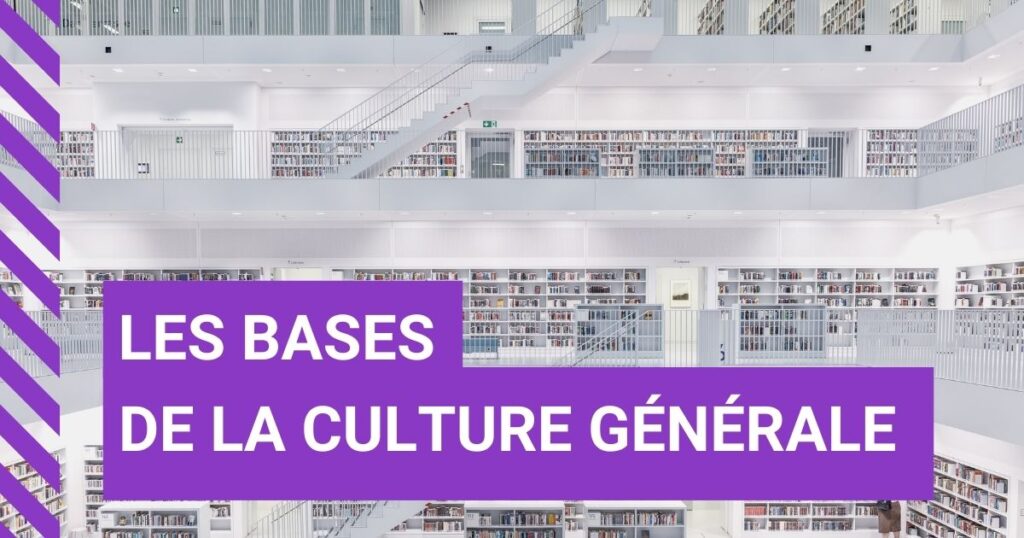
« Être cultivé, c’est disposer d’un minimum de connaissances émanant d’origines extrêmement diverses, et être capable de les faire communiquer entre elles. C’est se nourrir d’examen et d’auto-examen. C’est ne pas se fier au jugement d’autorité. »
Edgar Morin
La culture générale ? C’est l’ensemble des connaissances qui permet de situer les événements, de reconnaître les grandes œuvres, de comprendre les débats contemporains et de penser avec justesse les faits sociaux, politiques, économiques ou artistiques.
Pour améliorer sa culture générale, il faut commencer par définir son Pourquoi. Il faut que cette envie soit authentique, durable, bienveillante envers soi et avec les autres. Je développe tout cela dans mon article : Comment être cultivé. Prenez le temps de le lire, je vous explique aussi le processus et l’état d’esprit pour construire son socle de connaissances.
Mais peut-être que vous êtes au clair avec vos motivations, et peut-être que vous avez lu suffisamment de contenus sur la marche à suivre pour devenir plus cultivé. Il reste une question : que faut-il savoir ? Certes, la culture générale est un sujet personnel, mais il n’empêche que, être cultivé, c’est d’abord avoir acquis un certain nombre de repères essentiels, que chacun gagnera à aborder à son rythme, structurer et approfondir.

QUIZ : testez-vous avant de poursuivre !
Cliquez ici 👆 pour voir si vous avez besoin de lire cet article !
L’Histoire : discipline reine en culture générale
L’Histoire est la base de toute culture générale solide. Elle donne une grille de lecture pour naviguer dans n’importe quel autre domaine. Elle permet aussi de comprendre comment les sociétés humaines se forment, se transforment, s’affrontent, s’unissent ou s’effondrent. C’est l’Histoire qui éclaire les événements du présent, en en dévoilant les racines. Étudier l’histoire, c’est finalement prendre la hauteur, penser dans la durée et à relier les faits.
Nous vivons dans un monde bousculé par les enjeux internationaux, et c’est en étudiant l’Histoire que nous développons deux compétences utiles au quotidien : interpréter un problème global et prendre position sur un débat contemporain. Elle prépare à dialoguer avec des individus qui viennent d’autres cultures et à comprendre les tensions qui traversent nos sociétés.
Quelques repères importants en Histoire
- 5e siècle av. J.-C. : le siècle de Périclès à Athènes, qui voit naître la démocratie et la pensée occidentale
- 476 : chute de l’Empire romain d’Occident
- 622 : l’Hégire démarre le calendrier musulman avec l’émigration de Mahoimet à Médine et l’expansion de l’Islam
- 1492 : découverte de l’Amérique par Christophe Colomb
- 1789 : Révolution française
- 1914-1918 : Première Guerre mondiale
- 1939-1945 : Seconde Guerre mondiale
- 1989 : chute du mur de Berlin
- 2001 : attentats du 11 septembre aux États-Unis
- 2008 : faillite de Lehman Brothers, symbole de la crise des subprimes et début d’un effondrement financier mondial
La Littérature construit notre esprit critique
Il est essentiel de connaître quelques références littéraires pour, d’une part, évoluer sereinement dans certains environnements dits « cultivés » et, d’autre part, pour comprendre les allusions qu’on rencontre dans les médias, les discours publics ou les débats. Certains auteurs, certaines œuvres ou citations reviennentt régulièrement sans explication. Mieux vaut savoir les identifier pour ne pas être largué.
Certains textes littéraires sont devenus des repères parce qu’ils posent clairement (et fort joliment) les questions universelles : qu’est-ce qu’un homme libre, une société juste, une vie réussie ? Lire dix chefs d’œuvre permet déjà de participer à des échanges cultivés sans se sentir exclu, et d’avoir une base solide pour progresser à son rythme. Bien sûr, cela demande un effort. Mais ce sont les premiers pas qui coûtent. Et les pas suivants ouvrent un accès définitif au monde cultivé.
Pour aller plus loin : Comment lire plus et atteindre ses objectifs de lecture ?
Les principaux mouvements littéraires
- 8e avant JC au 5e après JC : épopées, tragédies et comédies de l’Antiquité gréco-latines (Homère, Sophocle, Virgile)
- 10e au 15e sicèle : littérature médiévale (Chrétien de Troyes, Dante, Villon)
- 16e siècle : Renaissance humaniste (Rabelais, Montaigne, Marguerite de Navarre)
- 17e siècle : Classicisme (Corneille, Racine, La Fontaine)
- 18e siècle : siècle des Lumières (Voltaire, Rousseau, Diderot)
- Début 19e siècle : Romantisme (Hugo, Chateaubriand, Musset)
- Milieu à fin 19e siècle : Réalisme et Naturalisme (Balzac, Flaubert, Zola)
- Fin du 19e au début du 20e siècle : Symbolisme (Rimbaud, Mallarmé, Valéry)
- 20e siècle (1930 à 1970) : Existentialisme et Nouveau Roman (Sartre et Camus, Duras et Robbe-Grillet)
- Depuis 1980 : Littérature contemporaine (Annie Ernaux, Patrick Modiano, Lola Lafon)
En savoir plus : Littérature française du 19ème siècle : les courants littéraires et les grands auteurs
L’Art pour être plus heureux
Et c’est un des domaines à connaître pour comprendre comment les sociétés fonctionnent à une époque donnée, ce qu’elles valorisent, ce qu’elles censurent. Aucune époque ne se comprend sans ses œuvres. Elles permettent d’identifier les normes en vigueur, les conflits d’idées, les formes de pouvoir. Étudier l’art, c’est apprendre à situer une œuvre dans un moment précis : à qui elle s’adresse, ce qu’elle autorise ou transgresse, ce qu’elle affirme ou remet en cause.
Et c’est un plaisir de reconnaître et surtout d’aimer les formes dominantes d’une période, les ruptures introduites par certains artistes, ou les techniques qui ont marqué un tournant. Ce savoir est nécessaire pour comprendre pourquoi certaines œuvres sont devenues célèbres, et ce qu’elles disent de ceux qui les ont produites ou admirées.
Aujourd’hui, cette compétence est utile pour savoir interpréter les images qui circulent en continu. Nous sommes saturés d’images : reportages, affiches, clips, publicités, contenus viraux. Être cultivé en art, c’est savoir prendre du recul sur ce qu’on regarde, et comprendre comment une image peut influencer une opinion ou transmettre un message.
Enfin, l’art ne sollicite pas seulement la mémoire ou les connaissances. Il agit aussi sur le cerveau. Regarder une œuvre, écouter une musique ou visiter un musée stimule la dopamine, l’ocytocine et les endorphines : des hormones liées au plaisir, à la curiosité et à l’attachement. Ce mécanisme explique pourquoi l’expérience artistique peut marquer durablement, renforcer l’intérêt, ou donner envie d’en savoir plus.
Quelques mouvements artistiques à connaître
- 15e au 16e siècle : Renaissance (Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël)
- 17e siècle : Baroque (Caravage, Rubens, Le Bernin)
- Fin 17e au début 19e: Classicisme (Poussin, Ingres, David)
- Début 19e siècle : Romantisme (Delacroix, Géricault, Friedrich)
- Milieu du 19e sicèle : Réalisme (Courbet, Millet, Daumier)
- 1870 à 1890 : Impressionnisme (Monet, Renoir, Degas)
- 1910 à 1930 : Abstraction (Kandinsky, Mondrian, Malevitch)
- 1907 à 1920 : Cubisme (Picasso, Braque, Juan Gris)
- 1916 à 1945 : Dadaïsme et surréalisme (Duchamp, Magritte, Ernst)
- 1945 à 1960 : Expressionnisme abstrait (Pollock, Rothko, De Kooning)
- 1960 à aujourd’hui : Art conceptuel et art contemporain (Kosuth, Abramović, Banksy)
Les sciences : notre boussole dans un monde technique
Vous savez quoi ? J’ai failli zapper les mathématiques et les sciences : un réflexe de littéraire que je voulais justement surmonter en créant ce blog. Mais une commentatrice avisée et bienveillante m’a remis dans le droit chemin car, oui, les sciences sont partout, elles structurent notre environnement et notre façon de raisonner.
Sans un bagage scientifique minimal, on ne comprend pas ce qu’est la matière, d’où viennent les phénomènes qu’on observe dans la nature, ou comment les corps vivants fonctionnent. La méthode scientifique repose sur des expériences rigoureuses et des raisonnements vérifiables (et surtout réfutables). Les mathématiques en sont le socle : un langage universel qui fait mal aux cheveux des littéraires permet de poser des problèmes clairs et de formuler des lois générales.
Une partie de la science s’applique à comprendre les phénomènes de manière théorique et via des expérimentations, sans se projeter dans aucune forme d’application concrète : c’est la science fondamentale. La science appliquée, elle mobilise les connaissances rationnelles pour résoudre des problèmes concrets. Cela dit, l’une ne va pas sans l’autre. Sans les mathématiques pures, pas d’internet. Sans la physique théorique, pas de GPS. Les avancées pratiques dépendent souvent d’intuitions venues d’ailleurs.
Pour finir, les sciences contemporaines ont quelque chose de magique : elles décrivent un réel de plus en plus contre-intuitif. La physique quantique, la théorie du chaos, ou l’astrophysique révolutionnent notre vision du réel, et c’est un vrai plaisir, amplifié par la science fiction (Interstellar et Tenet de Christopher Nolan, Premier contact de Denis Villeneuve, Une merveilleuse histoire du temps de James Marsh, et bien d’autres).
Les 10 grandes dates (ou étapes) de l’histoire des sciences
- -230 av. J.-C. : Ératosthènecalcule la circonférence de la Terre avec une ombre et un puits.
- 1543 : Nicolas Copernic publie De revolutionibus orbium coelestium : la Terre tourne autour du Soleil.
- 1687 : Isaac Newton publie Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica : naissance de la physique classique.
- 1789 : Antoine Lavoisier formule la loi de conservation de la matière : rien ne se perd, rien ne se crée (Traité élémentaire de chimie)
- 1859 : Charles Darwin publie L’Origine des espèces : théorie de l’évolution par sélection naturelle.
- 1865 : Gregor Mendel expose les lois de l’hérédité et marque le début de la génétique.
- 1905 : Albert Einstein publie sa théorie la relativité restreinte, suivie de la relativité générale en 1915.
- 1927 : Werner Heisenberg formule le principe d’incertitude. La mécanique quantique explose la logique classique.
- 1953 : James Watson et Francis Crick découvrent de la structure en double hélice de l’ADN.
- 2003 : fin du Projet Génome Humain : l’ADN de l’espèce humaine est séquencé.
La Géographie nous donne prise sur le monde
Au-delà des cartes colorées, la géographie donne des clés de lecture du monde globalisé, interconnecté, inégal et en mutation rapide dans lequel nous vivons. Localiser les 198 pays qui couvrent la planète Terre permet de situer correctement les ressources, les richesses, les zones à risques, et pas que.
La géographie est une discipline fondamentale pour comprendre les dynamiques du monde contemporain. Elle permet d’analyser les relations entre les sociétés humaines et leur environnement, en prenant en compte les aspects physiques, économiques, politiques et culturels.
Flux migratoires, échanges commerciaux et impacts du changement climatique sont familiers aux passionnés de géo. Ces derniers développent une capacité à lire et interpréter des cartes, à comprendre les enjeux liés à l’aménagement du territoire et à anticiper les conséquences des décisions politiques sur l’espace. Rien de tel également pour mieux appréhender les conflits territoriaux et les stratégies des acteurs internationaux.
La géographie est donc essentielle pour acquérir une culture générale authentique, car elle assure une compréhension globale des enjeux actuels et futurs. Elle permet de développer un esprit critique et une vision systémique des interactions entre les sociétés et leur environnement. Et elle nous évite, accessoirement, de parler à tort et à travers de régions que nous ne situons pas.
Quelques repères essentiels à s’approprier
- La population mondiale a franchi les 8 milliards fin 2022
- L’Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde en 2023, devant la Chine
- En 2050, 70 % des humains vivront en milieu urbain
- L’Afrique subsaharienne est la région dont la population augmente le plus vite
- Le Bangladesh, les Maldives et le delta du Nil figurent parmi les zones les plus menacées par la montée des eaux
- L’Amazonie perd l’équivalent de 18 arbres chaque seconde au Brésil (en 2021)
- 20 % du pétrole mondial transite par le détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique
- La Chine assure près de 30 % de la production industrielle de la planète
- Presque 150 millions d’enfants dans le monde, soit environ 1 sur 5 , souffrent de malnutrition chronique à un certain degré.
- Les 10 villes les plus peuplées du monde sont hors-Occident, et la première est Tokyo avec 37 468 00 habitants
La philosophie pour apprendre à vivre (et à mourir)
La philosophie pose des questions essentielles : qu’est-ce que la vérité ? qu’est-ce qu’une vie juste ? qu’est-ce qu’un raisonnement valable ? Elle donne les outils pour penser avec précision, pour évaluer les idées, et pour comprendre les principes qui orientent nos choix.
Elle aide à clarifier ce qu’on pense, à justifier ses jugements, à vérifier si l’on est cohérent avec soi-même. Elle permet d’interroger les opinions courantes, d’y résister quand il le faut, et de prendre position en connaissance de cause. C’est une discipline exigeante, mais accessible, qui structure l’esprit autant qu’elle éclaire l’action.
Depuis l’Antiquité, les philosophes ont cherché à mieux comprendre la réalité et à mieux vivre. Pour eux, ces deux objectifs sont liés : une vie bonne ne peut s’appuyer sur une idée fausse. La vérité n’est pas toujours confortable, mais elle reste la seule norme fiable.
Mettre la philosophie de côté, c’est s’exposer à mal formuler ce qu’on pense. De ce fait, les arguments deviennent flous et la prise de parole tourne court.
Quelques notions philosophiques de base :
- La maïeutique (Socrate) : méthode fondée sur le dialogue, qui pousse l’interlocuteur à accoucher de ses propres idées par le questionnement.
- La téléologie (Aristote) : toute chose a une fin propre, un but naturel à accomplir. C’est ce vers quoi elle tend (cause finale).
- Le Cogito (Descartes) : Je pense, donc je suis, certitude fondamentale sur laquelle fonder tout savoir.
- L’impératif catégorique (Kant) : principe moral universel selon lequel il faut agir comme si sa maxime devait devenir loi commune.
- La volonté de puissance (Nietzsche) : force vitale à l’origine des actions humaines, bien plus fondamentale que la morale traditionnelle.
- La valeur d’échange (Marx) : concept fondamental selon lequel la valeur d’un bien dans le capitalisme repose non sur son utilité (valeur d’usage), mais sur sa valeur marchande, détachée du besoin réel.
- Le ça, le moi et le surmoi (Freud) : structure tripartite de l’appareil psychique, où le ça porte les pulsions, le surmoi les interdits, et le moi tente de gérer le conflit.
- L’existence précède l’essence (Sartre) : idée selon laquelle l’homme définit lui-même ce qu’il est par ses choix, et non par nature.
- La déconstruction (Derrida) : méthode d’analyse des textes et des idées visant à révéler les oppositions cachées et les failles d’un discours.
- La justice comme équité (Rawls) : principe selon lequel une société juste est celle qu’on accepterait de rejoindre sans connaître sa place en son sein.
Politique : ce qu’il faut savoir pour sa culture générale
La politique encadre votre vie quotidienne : ce que vous payez en impôts, ce que vous touchez comme aides, les lois qui s’appliquent à votre travail, votre logement, vos libertés. Elle définit les règles du jeu collectif, mais aussi qui peut les changer, avec quels moyens, et pour quelles raisons.
Pour bien suivre une réforme, comprendre une crise gouvernementale ou interpréter un vote, il vaut mieux en connaître les enjeux : les institutions impliquées, les rapports de force, les options possibles. Sans ces repères, tout devient opaque. La politique n’est pas réservée à une élite : elle concerne tous ceux qui vivent sous ses règles.
S’y intéresser permet de déchiffrer l’actualité, de comprendre comment se prennent les décisions et ce qu’elles impliquent. Cela permet aussi d’exercer son droit de vote en connaissance de cause, de défendre ses intérêts et de repérer les choix qui engagent l’avenir d’un pays.
Quelques concepts fondamentaux à connaître
- Gauche / Droite : cette distinction est apparue durant la Révolution française en 1789, lorsque les députés favorables au pouvoir royal siégeaient à droite, les partisans du changement à gauche. Aujourd’hui, ces termes désignent deux ensembles d’idées. À gauche : égalité, redistribution, services publics. À droite : liberté individuelle, responsabilité, méfiance envers l’intervention de l’État.
- Progressisme / conservatisme : le progressisme défend les évolutions sociales (droits des minorités, bioéthique, mœurs). Le conservatisme valorise la stabilité, les traditions, l’ordre moral. L’une des subtilités à avoir en tête est qu’on peut être économiquement de droite et socialement progressiste, et inversement.
- Interventionnisme / libéralisme économique : l’interventionnisme défend un rôle actif de l’État dans l’économie (impôts, subventions, régulation). Le libéralisme économique limite ce rôle et mise sur la libre concurrence, le marché et l’initiative privée.
- Nationalisme / cosmopolitisme : le nationalisme met en avant l’attachement à la nation, la souveraineté, les frontières, à la culture nationale. Le cosmopolitisme insiste, lui, sur l’ouverture, la coopération internationale, la diversité culturelle.
- Proportionnelle / Scrutin majoritaire : la proportionnelle permet de représenter équitablement toutes les forces politiques, même celles qui sont minoritaires. Le scrutin majoritaire favorise au contraire la stabilité et les grands partis, ce qui exclut les petits partis du pouvoir.
- Régime parlementaire / régime présidentiel : dans un régime parlementaire (comme l’Allemagne), le gouvernement est subordonné au Parlement. Dans un régime présidentiel (ex. : États-Unis), le président est élu indépendamment du Parlement et concentre plus de pouvoirs.
- Séparation des pouvoirs : c’est un principe formulé par Montesquieu. Pour éviter la tyrannie, il faut séparer le pouvoir qui fait la loi (législatif) de celui qui l’applique (exécutif) et de l’institution qui sanctionne (le pouvoir judiciaire).
- Démocratie représentative : régime dans lequel les citoyens élisent des représentants pour décider en leur nom. Elle s’oppose à la démocratie directe, où les citoyens votent eux-mêmes les lois.
- Régime autoritaire / régime totalitaire : là encore une distinction subtile mais essentielle. Un régime autoritaire limite les libertés, mais sans chercher à contrôler toutes les sphères de la vie. Un régime totalitaire, lui, impose une idéologie unique, contrôle l’information, la culture, l’éducation, la vie privée (ex. : URSS de Staline).
- État-providence : on parle ici d’un modèle d’organisation sociale dans lequel l’État garantit un certain niveau de protection (santé, retraite, chômage, logement). À quoi est associé des systèmes de redistribution financés par l’impôt ou les cotisations.
L’économie pour répondre aux défis de la vie et de la citoyenneté
L’économie, ou science économique, donne les clés pour évaluer les décisions publiques qui influencent les revenus, les prix, les impôts, l’emploi, les aides sociales et les conditions de production. Elle donne des repères précis pour analyser les politiques mises en œuvre par l’État, les banques centrales et les grandes entreprises.
Concrètement, une bonne culture politique permet d’interpréter certaines mesures majeures : une réforme fiscale modifie la redistribution des richesses ; une variation du taux directeur influe sur les crédits et l’épargne ; un plan d’investissement public réoriente les priorités nationales. Dans tous les cas, ces décisions ont des effets directs sur le pouvoir d’achat, le chômage, le financement de l’hôpital, le coût du logement, ou la retraite.
Comprendre ces mécanismes suppose de connaître les notions fondamentales : inflation, croissance, productivité, déficit budgétaire, dette publique, taux d’intérêt. Ces termes sont présents dans tous les débats politiques. Les maîtriser permet de suivre une loi de finances, d’évaluer un programme électoral, de ne pas se laisser tromper par des chiffres présentés sans contexte.
Sans ces repères, vous n’êtes pas en mesure d’évaluer les choix des décideurs économiques ou des experts qui tranchent en votre nom !
Pour aller plus loin : L’économie est-elle une science ?
Quelques notions économiques essentielles
- Offre et demande : mécanisme fondamental du marché, qui fait varier les prix selon la disponibilité d’un bien et l’intérêt qu’on lui porte.
- PIB (Produit Intérieur Brut) : indicateur central qui mesure la richesse produite par un pays en un an.
- Inflation : augmentation durable des prix ; elle grignote le pouvoir d’achat quand les revenus ne suivent pas.
- Taux d’intérêt : coût de l’emprunt ; il influence les crédits, les investissements et l’épargne.
- Déficit public : situation où l’État dépense plus qu’il ne perçoit de recettes, sur une année.
- Dette publique : somme des emprunts accumulés par l’État pour financer ses déficits successifs.
- Chômage conjoncturel vs chômage structurel : le premier dépend de la situation économique ; le second résulte de problèmes durables comme la formation ou la localisation des travailleurs.
- Libéralisme économique : doctrine issue d’Adam Smith, qui défend un État minimal et le rôle central du marché.
- Keynésianisme : théorie de John Maynard Keynes, qui justifie l’intervention de l’État pour soutenir l’économie en période de crise.
- Développement durable : mode de croissance qui cherche à concilier progrès économique, justice sociale et respect des limites écologiques.
Le sport influence l’Histoire
On peut vivre sans sport, mais on ne peut pas comprendre le monde sans en maîtriser les bases. Le sport occupe une place centrale dans la vie collective : il déclenche des célébrations nationales, impose ses figures dans l’actualité, provoque des débats sociaux ou politiques à l’échelle mondiale.
Aujourd’hui, les compétitions sportives mobilisent des milliards d’euros, des centaines de millions de spectateurs, des intérêts diplomatiques et économiques majeurs. Le sport influence les rapports de force entre pays et inversement. Le discours médiatique en est impacté, ainsi que le divertissement. Le sport touche au marketing, à la gestion des corps, à la place des femmes, à la représentation des minorités. Il est devenu un levier de pouvoir.
Dans ce contexte, ignorer le sport, c’est passer à côté du sens profond de certains événements (émeutes, boycotts, podiums polémiques…) Le sport agit comme un révélateur : il montre ce qui rassemble, ce qui divise, ce qui dérange. Et il s’agit moins de suivre tous les championnats que de garder en tête les dates-clés, les figures marquantes et les différentes institutions qui encadrent le sport national et mondial.
Quelques pivots marquants dans l’histoire du sport
- –776 av. J.-C. : premiers Jeux olympiques organisés à Olympie en Grèce antique
- 1896 : naissance des Jeux olympiques modernes à Athènes, sur l’initiative de Pierre de Coubertin
- 1930 : la première Coupe du monde de football est organisée et remportée par l’Uruguay
- 1960 : premiers Jeux paralympiques à Rome, moment fondateur pour le sport accessible aux personnes en situation de handicap
- 1968 : poing levé de Tommie Smith et John Carlos aux JO de Mexico, geste fort contre les discriminations raciales
- 1972 : attentat contre la délégation israélienne aux JO de Munich, bascule dans l’ère du sport exposé au terrorisme international
- 1981 : Pelé prend sa retraite, il incarnait le football mondial en tant que culture populaire planétaire
- 1995 : Nelson Mandela soutient les Springboks pendant la Coupe du monde de rugby, geste fort pour la réconciliation post-apartheid
- 1998 : La France est sacrée championne du monde de football (et réédite l’exploit 20 ans plus tard, en 2018)
- 2008 : Jeux olympiques de Pékin, démonstration du soft power chinois et vitrine géopolitique
Les langues étrangères nous ouvrent l’esprit
La maîtrise (au moins à l’écrit) d’au moins une langue étrangère est l’indice d’une bonne culture générale. Connaître d’autres langues que la sienne ouvre l’esprit à d’autres manières de penser, de s’informer et d’échanger. Et, plus concrètement, cela agrandit nos horizons, car tous les contenus intéressants ne sont pas traduits en français, très loin de là !
L’anglais reste la langue la plus utile à l’échelle mondiale, puisqu’il est dominant dans les sciences, la presse internationale, la diplomatie, les affaires. Être anglophone facilite grandement les voyages et certains emplois. Mais cela permet aussi de consulter directement les textes de référence et de suivre des débats internationaux dans le texte. De plus, cela
Cela dit, d’autres langues occupent le devant de la scène internationale : l’espagnol, l’arabe, le mandarin, le portugais ou l’hindi. Les connaître ou simplement les localiser sur une carte permet de mieux comprendre la structure du monde. Et prendre conscience qu’il existe environ 7 000 langues, qui ont chacune leur dignité, est un pas décisif vers une vie plus riche.
L’étape suivante, c’est l’apprentissage d’une seconde, voire troisième langue, un effort qui en vaut largement la peine. Apprendre une nouvelle langue aide à mieux comprendre celle(s) qu’on connaît déjà. Vous en devenez plus attentif aux nuances, plus précis dans l’expression, plus souple dans le raisonnement. Et c’est un excellent exercice d’empathie !
Quelques faits intéressants à connaître sur les langues étrangères
- Il existe environ 7 000 langues dans le monde, mais seules 100 sont utilisées dans l’enseignement ou les médias.
- Le mandarin est la langue maternelle la plus parlée (900 millions de locuteurs natifs), mais l’anglais reste la langue la plus utilisée à l’échelle internationale.
- Le français est la 10e langue du monde par nombre de locuteurs, derrière l’anglais, l’espagnol, le hindi, l’arabe, le bengali, le portugais, le russe, etc.
- Les langues indo-européennes (français, allemand, hindi, persan) couvrent la majeure partie de l’Eurasie. Les langues sino-tibétaines, comme le mandarin, forment le deuxième groupe mondial.
- Les langues sémitiques (arabe, hébreu, araméen) reposent sur un système de racines consonantiques (par exemple : K-T-B pour écrire, en arabe).
- Les langues isolantes (comme le chinois) ne modifient jamais les mots ; les langues agglutinantes (comme le turc, le japonais) ajoutent des suffixes pour exprimer les relations.
- Le basque est une langue sans parenté connue : c’est un isolat linguistique toujours vivant.
- Un mot comme maman existe dans presque toutes les langues, car les sons /m/ et /a/ sont les plus faciles à produire pour un nourrisson.
- Seules 100 à 200 langues ont une littérature écrite enseignée à l’école. Les autres sont majoritairement orales.
- Une langue disparaît environ tous les 15 jours, faute de transmission : le paysage linguistique mondial se réduit rapidement.
Développer les bases de la culture générale : les questions habituelles
C'est une démarche incontournable pour réussir dans des concours comme ceux des grandes écoles (HEC, Sciences Po, ESSEC, etc.), en particulier à l'épreuve orale où la capacité à discuter de sujets contemporains et à faire une synthèse de documents fait la différence. Mais peut-être souhaitez-vous aussi briller dans des discussions professionnelles ou amicales, développer votre capacité à argumenter et à analyser des sujets complexes.
Lisez des livres. C'est la base, et prenez des notes de lecture. Ensuite, complétez en écoutant des podcasts sur des sujets variés, en jouant à des jeux de culture générale ou en testant vos connaissances à travers des quizz en ligne. Par exemple, les jeux de questions, les concours de culture générale, ou encore les jeux de société comme Trivial Pursuit sont des moyens amusants et efficaces pour renforcer vos connaissances. Vous pouvez aussi suivre des cours en ligne, notamment pour des sujets comme l'histoire de France ou des disciplines comme les sciences humaines et les langues vivantes.
Exceller ? Belle ambition. Il faut, pour cela, développer non seulement vos connaissances, mais aussi votre capacité à les analyser. Vous irez plus loin (et plus vite) en vous exerçant à l'argummentation et à la synthèse de documents sur divers types de sujets divers, comme la politique, les sciences sociales ou l’histoire. Ce sont des piliers de l'enseignement en prépa. La culture générale pour les nuls comme vous et moi, et qui souhaitent exceller, se base sur la curiosité, l’apprentissage continu, et la pratique régulière à travers des tests de culture générale.
Pour réussir les épreuves de culture générale au bac (en terminale S, L, ES, ou STI2D), il est essentiel de réviser régulièrement et de tester vos connaissances en épluchant les annales et les tests et quiz de culture générale. Vous pouvez aussi utiliser des ressources comme les podcasts, les cours en ligne, et les intégrer dans vos fiches de révision.
Il existe une foule de moyens pour se cultiver de manière ludique. Les jeux de quiz (comme Trivial Pursuit), les jeux télévisés, ou même des jeux concours en ligne vous permettent de tester vos connaissances en vous amusant, et ensuite, immédiatement après chaque séance ou émission, de combler vos lacunes. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes de discussion et/ou commencer un blog (comme celui-ci 😉). Enfin, les documentaires et les cours de culture générale en ligne sont parfaits pour enrichir vos connaissances de manière immersive. Dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'un article sur les les meilleures ressources gratuites pour se cultiver.
Ce qu’il faut savoir en culture générale : à vous de jouer !
Au sens minimal, disons académique, la culture générale cible quelques disciplines reines : histoire, géographie, arts, musique, littérature, sport, politique, philosophie, économie, langues. Dans chacun de ces domaines, on peut identifier des éléments de connaissance à s’approprier en priorité.
Pourquoi commencer par ceux-là ? Parce que sans ce premier socle, on passe à côté de nombreux textes, certains débats nous échappent, on reste coi devant les références qu’on n’a pas. À l’inverse, les connaître permet de s’y retrouver et d’interagir, de s’exprimer clairement.
Vous avez maintenant les repères. Il ne reste qu’à choisir une entrée et à commencer. Un chapitre, une date, un concept, une carte. À force de lire et de mémoriser, tout devient plus clair et plus lisible. La culture générale, c’est ce qui vous permet de comprendre votre environnement, de parler avec assurance, et de ne pas laisser les autres penser à votre place.
Alors ? Quel domaine avez-vous envie de consolider en premier ? Et, question bonus : pour quelles raisons ? Ça m’intéresse vraiment de le savoir, éclairez-moi dans les commentaires 🙏

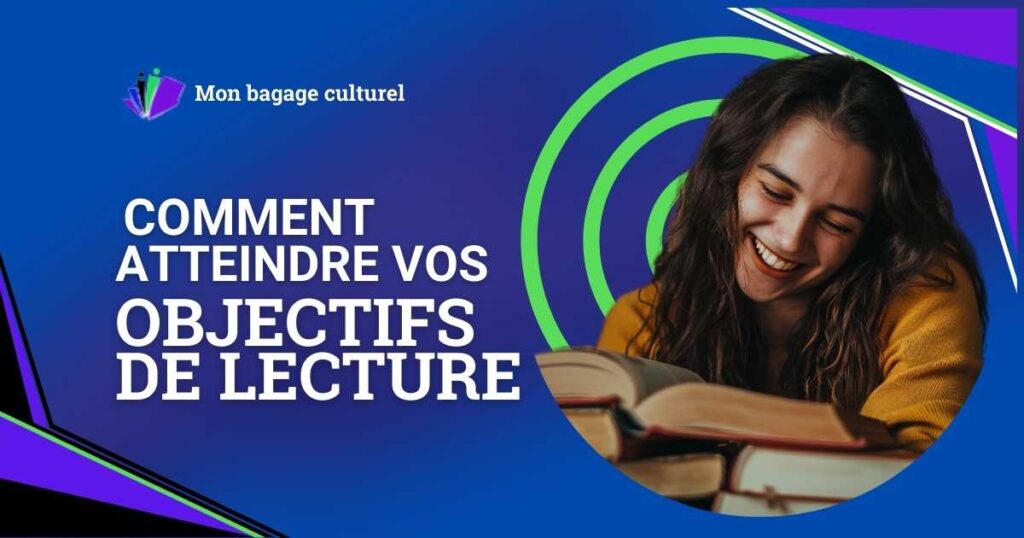
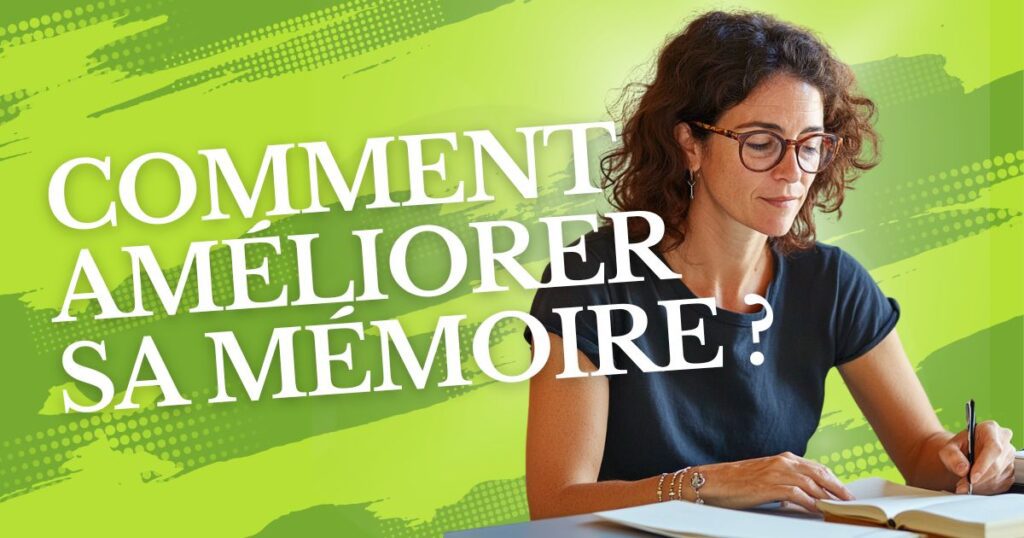
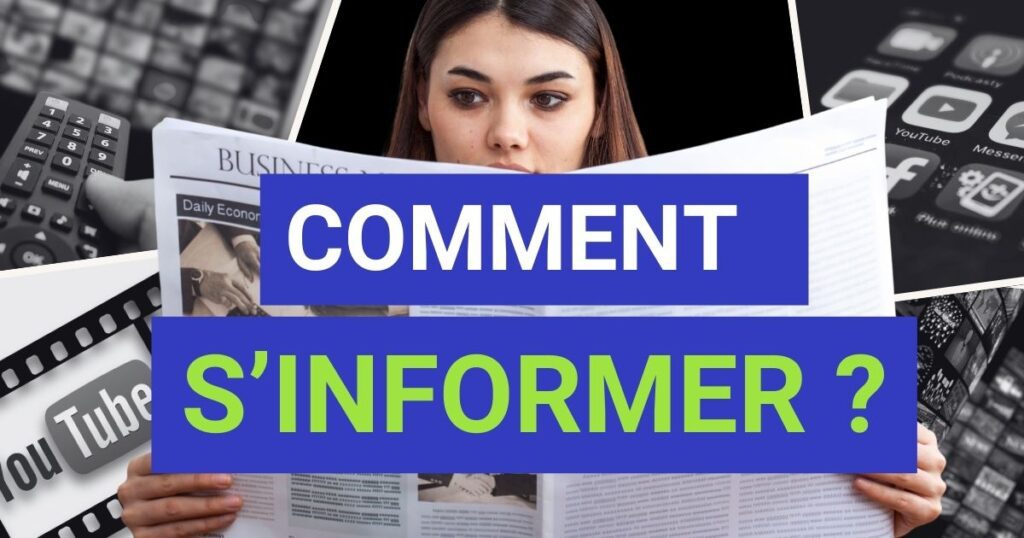
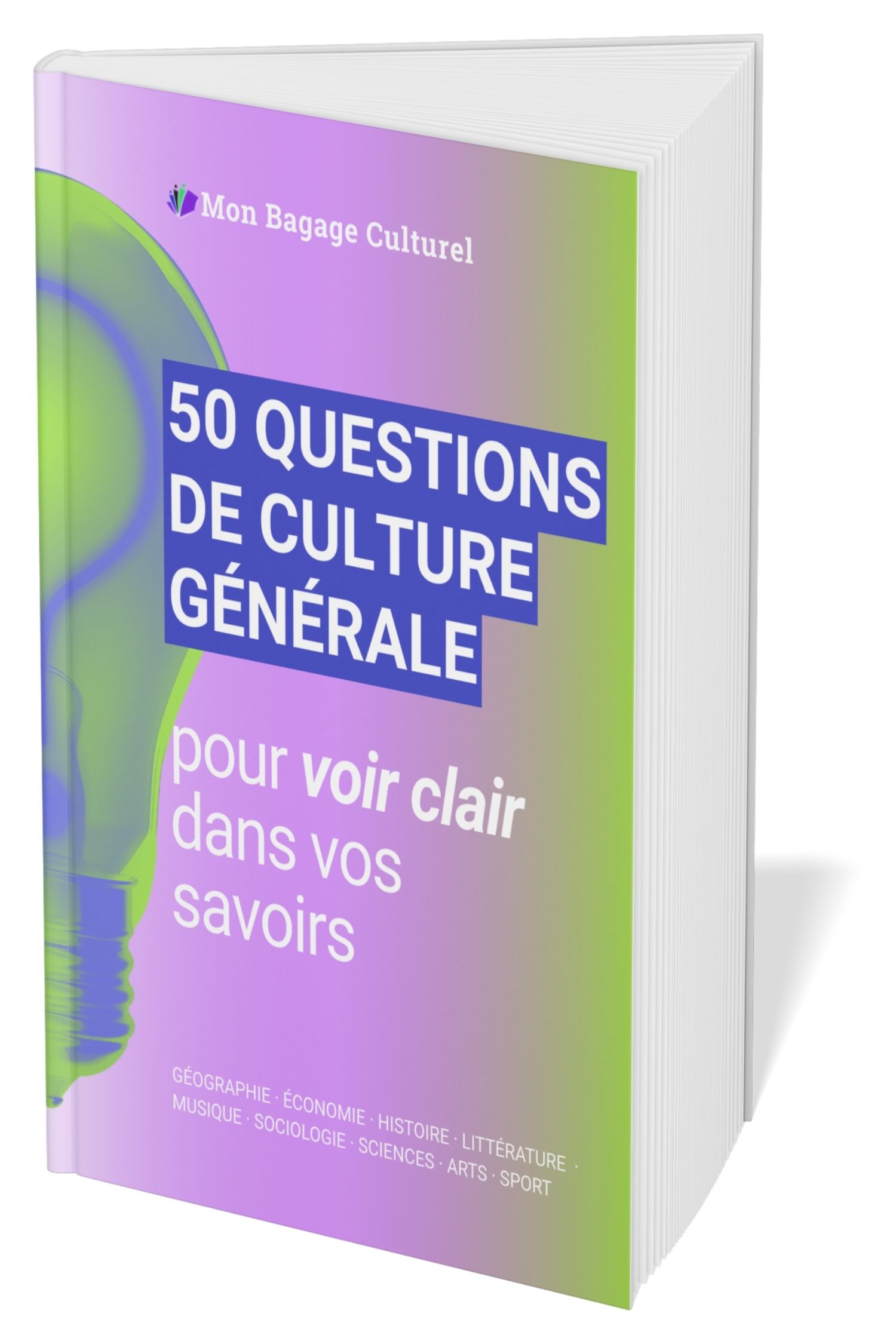
En complément des indispensables bouquins, on peut aussi traverser nos frontières internes et « comprendre des choses » grâce aux documentaires !
Sur ma « playlist », en priorité :
• Nous sommes des champs de bataille de Mathieu Rigouste, 2024
• Howard Zinn, une histoire populaire américaine Vol. 1 de Olivier Azam et Daniel Mermet, 2014 (et le 2 va sortir dans quelques mois)
• Riverboom de Claude Baechtold, 2023
Oh oui, Certaldo, les documentaires sont un moyen quelque peu addictif d’élargir nos horizons. Merci d’être passé par ici, et pour ces 3 titres que j’ai hâte de visionner 🤗
Merci pour ton article, super utile pour y voir clair et se motiver à se plonger dans la culture générale. Les grands thèemes sont bien posées, on sait par où commencer … ou reprendre !
Petite remarque au passage : j’ai été un peu surpris·e de ne pas voir passer les maths ou les sciences. Elles comptent aussi pas mal, je trouve que les maths, par exemple, nous apprennent à raisonner, à observer, à douter… et les sciences aident à comprendre plein d’enjeux actuels comme le climat ou le numérique.
Peut-être le sujet d’un prochain article ?
Je savais bien que j’avais oublié quelque chose 🙃. C’est mon tropisme littéraire qui m’a joué des tours, et j’ai allègrement mis de côté le « quadrivium », à savoir les disciplines fondées sur les mathématiques. C’est pourtant ce tropisme assez limitant, ces oeillières « sciences humaines » justement, qui m’a poussée à créer ce blog pour élargir mes horizons ! Alors un grand merci pour ce rappel.
C’est parti pour le rajout d’une section !
Une excellente piqûre de rappel sur l’importance de la curiosité au quotidien. La culture générale n’est pas un luxe, mais un passeport pour mieux comprendre le monde et s’y mouvoir avec agilité. Bravo pour ce tour d’horizon clair et motivant !
Merci beaucoup Jackie ! J’adhère à ta vision, la culture a parfois mauvaise presse, avec régulièrement des procès d’inutilité, alors qu’elle n’a jamais été aussi vitale !
J’ai bien aimé lire ton article ! Sur Evernote, j’ai pris plein de notes pour approfondir certains sujets. Tu as bien résumé les fondamentaux de l’histoire, la géographie, etc., et ce fut passionnant à lire 👌.
Pour ma part, j’explore surtout avec des atlas. Notamment ceux de Christian Grataloup. Avec les cartes et les explications, c’est plus simple pour moi. Je fais ça en pur amateur et pur plaisir.
Le pire, c’est que je détestais ces matières à l’époque. Maintenant, je me rends compte des parallèles que l’on peut faire avec le monde d’aujourd’hui. Je me découvre aussi que les films, séries, mangas, etc., s’inspirent fortement de l’histoire. On va directement aux sources primaires.
Répondre à la question « Pourquoi’ me passionne personnellement. Et ton article va m’aider à me guider dans mes recherches. Merci pour toutes ces infos !
Merci à toi, David ! C’est marrant qu’on ait les mêmes réflexes de développement culturel en autodidacte. Comme toi je ne voyais pas l’intérêt d’étudier la géographie (ou l’économie), mais finalement toutes les disciplines valent d’être explorées.
Merci pour ton article et de considérer la culture générale comme quelque chose d’important. Tu ne parles pas de spiritualité et je ne veux pas dire religion parce que la spiritualité on la retrouve partout et surtout dans les relations humaines.
Oui, tu as mille fois raison, la spiritualité a toute sa place, et pas au dernier rang. Je ne l’ai pas intégrée dans cet article, parce que j’ai choisi de présenter le socle académique, tel qu’il est défini dans les cadres universitaires et institutionnels. Mais ta remarque est super juste. La culture générale est ce qui nous constitue, et donc c’est une affaire spirituelle, de bout en bout. D’autant que pour moi, la culture générale aujourd’hui doit chercher à préserver ce qui fait l’humain : sa mémoire, sa pensée, la transmission.
Je vais ajouter un encart pour clarifier ce cadrage restreint. Et j’ai bien l’intention d’écrire plusieurs articles sur la spiritualité. Merci!
Eva ton blog file directement dans mes favoris ! J’ai cette soif d’apprendre, et la culture est tellement vaste qu’il est impossible de tout savoir en une seule vie. J’adore ton concept de blog ! 😀 Il est riche et passionnant. J’ai adoré me replonger dans ces dates clés… Je viens de faire un aller-retour express dans le temps… sans décalage horaire ! 😉
😳 Merci 🥰 C’est toujours un bonheur de voir que ma passion est partagée !
Excellent et synthétique. Merci.
Merci à toi, Xavier 🙂
Ping : Chronologie de l'histoire de France