"La culture ne s'hérite pas. Elle se conquiert." — Je suis ravie de vous accueillir sur Mon Bagage Culturel ! Pour commencer, téléchargez votre test : 50 questions pour faire le point sur vos savoirs 🙂
Heureuse de vous revoir sur Mon Bagage Culturel ! Et si vous faisiez le point sur votre culture générale ? Je vous propose un test de 50 questions, pour repérer où vous en êtes… et identifier les prochaines étapes 🔥. Téléchargez-le ici, c’est gratuit:)

« Rendre accessibles au plus grand nombre les œuvres capitales de l’humanité et d’abord de la France » [1].
C’est la noble mission que s’attribue le ministère de la Culture.
La culture générale est pensée comme un droit commun, à transmettre largement. Dans cet esprit, les politiques publiques multiplient les dispositifs pour l’égalité d’accès : éducation artistique, diffusion numérique, soutien à la création.
Dans les faits, la culture est rendue disponible gratuitement dans bien des formats. Mais nous allons voir dans cet article que cette abondance ne suffit pas à progresser dans sa culture générale.
La « culture G » est un marqueur social déguisé en mérite personnel
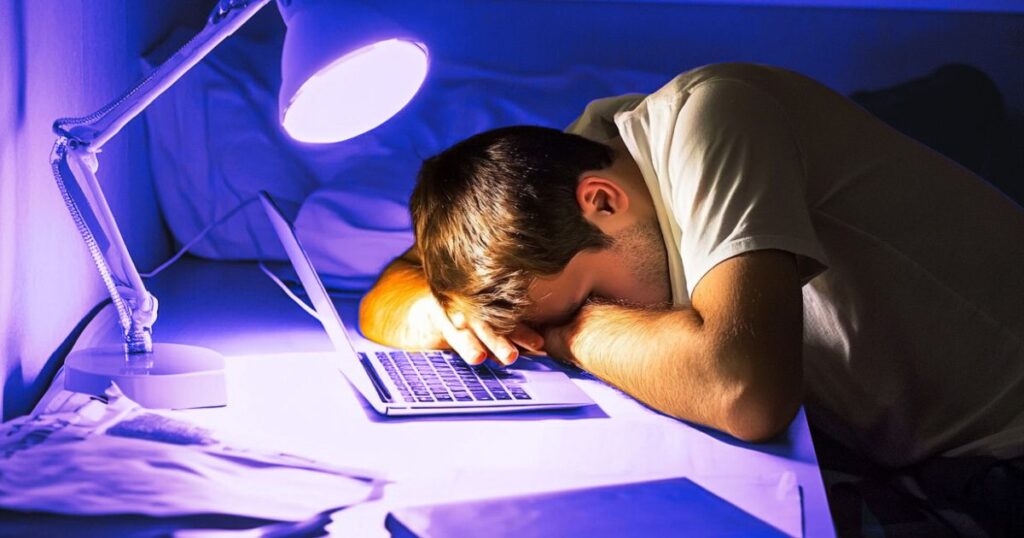
C’est dans les concours que l’illusion de la méritocratie est la plus forte.
Stéphane Benvéniste, post-doctorant à l’Institut national d’études démographiques (INED) a établi que les enfants d’anciens diplômés des grandes écoles ont 80 fois plus de chances de réussir le concours. « Les enfants de l’élite bénéficient d’un « double dividende »[2] : ils descendent de plusieurs générations de diplômés qui, ensuite, forment des dynasties politiques.
En revanche, les enfants de milieux populaires, même brillants, même motivés, doivent tout apprendre. Les codes, les auteurs et disciplines hors-programme, la façon d’en parler. Et souvent, ils n’en ont pas conscience, persuadés que la culture d’élite est une affaire de dureté au travail, de mémoire ou de goût.
En d’autres termes, les candidats se présentent à une épreuve de culture générale neutre, censée récompenser leurs efforts d’acquisition de connaissances, de réflexion et d’analyse. En réalité, elle récompense la familiarité avec un certain monde.
Il ne s’agit pas seulement de connaître un auteur, mais de savoir le citer au bon moment, dans la bonne forme. Il ne s’agit pas d’avoir un avis, mais de savoir l’argumenter dans le style attendu.
Ce style, on ne l’apprend pas dans les manuels. On s’en imprègne depuis l’enfance. On l’entend à table, dans les échanges avec des professeurs bienveillants. Il se forme dans les voyages culturels, les séjours linguistiques, les pièces de théâtre vues jeunes, les livres offerts à Noël, les remarques pertinentes, les modèles admirés.
La culture d’élite est un costume taillé sur mesure pour une classe sociale, que les autres essaient de enfiler sans patron.
L’égalité d’accès par la gratuité est un mythe

Même si les ressources culturelles sont aujourd’hui techniquement plus accessibles que jamais, (cours en ligne, podcasts, vidéos, musées gratuits, bibliothèques numériques), ce n’est pas suffisant pour corriger ces inégalités de capital culturel. La disponibilité ne crée pas la mobilisation.
Depuis 2009, l’entrée aux collections permanentes des musées nationaux est gratuite pour les jeunes ressortissants de l’Union européenne âgés de moins de 26 ans. Cette mesure s’ajoute aux dispositifs publics déjà en place.
Mais l’expérience montre qu’il ne suffit pas d’ouvrir l’accès aux contenus pour que les citoyens s’en emparent. En 2023, seulement 27 % des jeunes de moins de 25 ans avaient profité de la gratuité des musées nationaux [3].
Ce n’est donc pas parce qu’une porte est ouverte que nous allons tous la franchir. Parce que cette porte-là demande bien plus qu’un pas en avant. Elle demande du travail et de l’accompagnement👇
L’importance invisible du travail pour conquérir la culture

Toute l’ambiguïté des discours officiels sur la culture tient dans cette illusion d’une « envie de culture » qui serait innée. En présentant l’appétit pour la culture comme un élan naturel, on fait croire que le fait d’aimer l’opéra, de comprendre Spinoza, ou de s’enthousiasmer pour l’art roman est une question de goût personnel.
En réalité, l’intérêt pour la culture vient avec l’effort et la fréquentation assidue. On ne comprend Proust qu’après des heures de lecture attentive et… persévérante. On ne s’intéresse à Platon qu’après l’avoir lu, relu, et en avoir discuté avec un professeur.
Ce n’est pas la motivation ou l’intérêt qui doivent précéder le travail, mais l’inverse : c’est le travail qui, très largement, précède l’intérêt. On ne s’intéresse jamais vraiment qu’à ce sur quoi on a, au préalable, beaucoup travaillé.
Luc Ferry, De l’amour : Une philosophie pour le XXIe siècle
Ce point est ignoré par les politiques publiques qui imaginent qu’on déclenche le goût culturel en plaçant des œuvres un peu partout. Le rapport Alain Seban (2013) critique explicitement cette logique : il recommande de conditionner les prêts ou dépôts d’œuvres, dans les gares, aéroports, écoles, prisons, hôpitaux, à un vrai dispositif de médiation [4].
Pour Seban, ces initiatives « hors les murs » amènent bel et bien l’art ceux qui ne franchissent jamais la porte des musées, mais à une condition : proposer un accompagnement et un vrai suivi. Car exposer une œuvre dans les prisons ou les gares sans aucun guide ne permettra pas au public ciblé de l’apprécier. Le goût ne s’attrape pas comme un virus aéroporté.
Pour preuve une recherche au Science Museum de Milan a comparé trois types de visite : visite en solo, visite guidée et atelier. Elle montre clairement que les visites guidées et les ateliers aident les visiteurs à mieux comprendre ce qu’ils voient, à retenir plus d’informations et à relier les œuvres. À l’inverse, les visites libres laissent souvent les gens seuls face à des objets qu’ils regardent sans vraiment savoir quoi en penser. [5]
La culture générale est une culture d’élite qui discrimine plus qu’elle ne rassemble
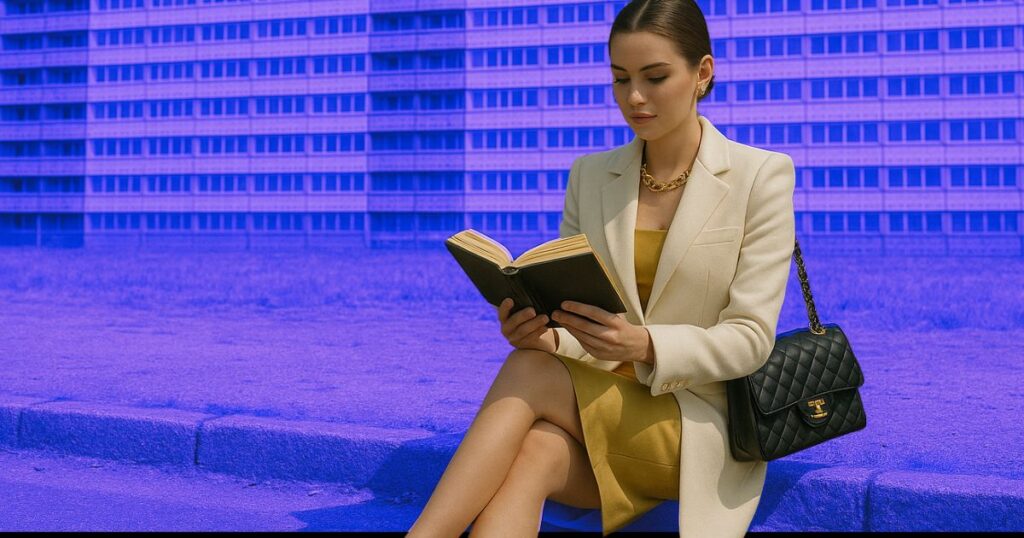
La culture reste un outil de distinction, dans la mesure où elle permet aux groupes sociaux dominants de se reconnaître entre eux et d’exclure les autres sans en avoir l’air.
Le sociologue Pierre Bourdieu a analysé ce mécanisme, et il appelle « violence symbolique » le fait, pour les dominants, de faire passer leurs propres goûts pour des références évidentes, que tout le monde devrait partager.
L’école et les médias transmettent ces codes sans dire qu’ils sont les codes d’un milieu particulier. Les dominants les présentent comme naturels, puis s’en servent pour juger ceux qui ne les maîtrisent pas. En accusant les autres de manquer de culture, ils renforcent la hiérarchie sociale. Je vous redis cela avec les mots du penseur :
…et les dominés que la magie du pouvoir symbolique déclenche, et par lesquels les dominés contribuent, souvent à leur insu, parfois contre leur gré, à leur propre domination en acceptant tacitement les limites imposées, prennent souvent la forme d’émotions corporelles – honte, humiliation, timidité, anxiété, culpabilité – ou de passions et de sentiments – amour, admiration, respect – ; émotions d’autant plus douloureuses parfois qu’elles se trahissent dans des manifestations visibles, comme le rougissement, l’embarras verbal, la maladresse, la colère ou la rage impuissante, autant de manières de se soumettre, fût-ce malgré soi et à son corps défendant, au jugement dominant, autant de façons d’éprouver, parfois dans le conflit intérieur et le clivage du moi, la complicité souterraine qu’un corps qui se dérobe aux directives de la conscience et de la volonté entretient avec les censures inhérentes aux structures sociales. Pierre Bourdieu, La Domination masculine
On le voit encore clairement aujourd’hui : dans l’Union européenne, les 20 % les plus riches participent au moins deux fois plus aux activités culturelles que les 20 % les plus modestes [6].
En France, le sociologue Jean-Christophe Raffin observe que les politiques culturelles continuent de mettre en avant une « bonne culture », souvent réservée à ceux qui en ont déjà les codes. Selon lui, cela crée une forme d’exclusion : ceux qui ne sont pas familiers avec cette culture ne s’y sentent pas à leur place. [7].”
Le paradoxe de l’ère numérique : trop de connaissances 👉 l’attention s’effondre

Pourtant, l’offre culturelle a explosé. Films, podcasts, expositions, concerts, archives en ligne : tout est accessible, jour et nuit. Cette accessibilité massive devrait favoriser l’apprentissage et la curiosité. Mais en réalité, elle provoque souvent l’effet inverse.
L’économie de l’attention, concept popularisé par Herbert Simon en 1971, repose sur un postulat fort [8] :
« L’abondance d’informations entraîne la pénurie de l’attention » .
Autrement dit, face à un flux permanent de contenus, c’est notre capacité à nous concentrer qui devient la ressource rare.
En France, Yves Citton s’en empare dans Pour une écologie de l’attention (2014) : il alerte sur une compétition artificielle pour capter notre regard. Cette dynamique fragilise notre capacité à prendre le temps, à nous immerger et à opérer des choix éclairés.[9].
Concrètement, les algorithmes de plateformes et de réseaux sociaux priorisent les formats courts, les thématiques choc et les rebonds émotionnels. Leur objectif ? Nous garder connectés, non pas nous instruire. Résultat : nous zappons de sujet en sujet, souvent sans mémoriser, pour mieux subir la prochaine recommandation.
Dans cette surcharge informationnelle, il faut avoir de sacrées ressources pour tirer parti de l’abondance : avoir le temps et les bases culturelles et émotionnelles nécessaires pour ralentir le rythme et choisir les contenus qui méritent notre attention. Autrement dit, avoir reçu une éducation de grande qualité.
Vous pouvez approfondir en lisant mon résumé du livre de Bruno Patino : La civilisation du poisson rouge. Petit traité sur le marché de l’attention
La culture reste un levier social pour les non-privilégiés

Malgré tout, la culture est foncièrement synonyme d’espoir. Pour les personnes issues de milieux modestes, elle constitue un précieux levier d’émancipation, à condition qu’elle ne se limite pas à une consommation passive.
Les grandes écoles utilisent depuis longtemps des pratiques pédagogiques exigeantes :
- Apprendre à rédiger une dissertation argumentée, via des pratiques régulières et structurées, comme on le voit en prépa où la méthodologie est formellement enseignée.
- Croiser les disciplines dans un même raisonnement, comme le recommandent les épreuves de culture générale.
- Débattre, confronter des idées en toute rigueur dans des séminaires ou ateliers.
- Recevoir un accompagnement personnalisé, via des tutorats, comme dans les « prépas Talents » où les étudiants bénéficient d’un soutien régulier et individualisé
- Penser collectivement, grâce aux échanges, aux retours des pairs et à des évaluations en groupe.
Ces techniques (qu’on pourrait appeler les secrets de fabrication de la pensée rigoureuse) ne sont pas réservées aux grandes écoles. Mais elles exigent du temps, de l’effort, un accompagnement constant, ce qui reste rare en dehors de ces filières.
Or, c’est justement ce que le système public ne peut plus garantir. En 2024, le budget du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a été réduit de 904 millions d’euros [10]. En 2025, il a encore chuté de 31,5 à 26,7 milliards [11]. Plus de 60 universités sont désormais en déficit, et certaines coupent dans les postes, les heures de cours, les services aux étudiants [12].
Dans ces conditions, comment prétendre offrir à tous un accès égal aux méthodes d’apprentissage qui permettent de structurer une culture ? Tant que ces pratiques resteront réservées à quelques filières d’élite, la culture générale restera un facteur d’exclusion, et non un outil de démocratisation.
Mon expérience d’autodidacte en Culture G
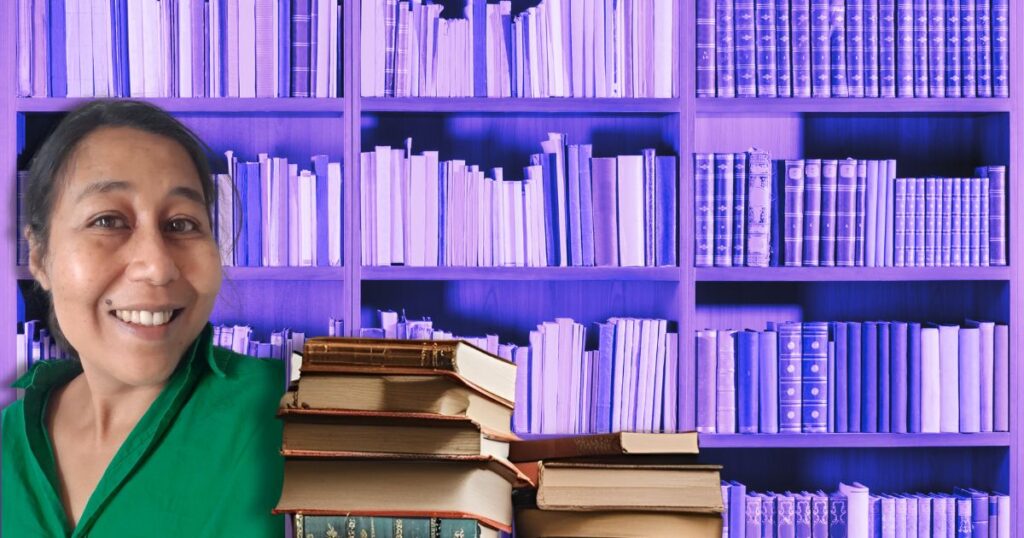
Passionnée de littérature et diplômée en Lettres modernes, je suis moi-même autodidacte en culture générale. C’est-à-dire que j’ai engagé, à 24 ans, une démarche personnelle pour acquérir les connaissances que j’estimais nécessaires à ma vocation d’écrivaine. Concrètement je voulais documenter mon roman, avec pour modèles des auteurs « totaux », bâtisseurs de monde (Shakespeare, Balzac, Proust, Döblin, Borges, DeLillo et tant d’autres).
J’ai donc pris une année sabbatique pour étudier intensivement en bibliothèque. Mon objectif était de compenser les lacunes de mon cursus universitaire, mais aussi, clairement, de légitimer ma culture, en passant en revue les dix grandes classes de la classification Dewey à Beaubourg, puis les rayons de la Cité des Sciences.
Je ne prétends pas être Jack London ni André Malraux qui, eux aussi, se sont cultivés par eux-mêmes. Mais je suis la preuve qu’il est possible de se cultiver seul, à coup de livres, comme dirait la chanson. Sauf que cela m’a demandé un engagement structuré, de la discipline et, surtout, la ressource rare que mes parents m’ont offerte sans sourciller : beaucoup, beaucoup de temps.
Alors, la culture G, pourquoi faire ?

La culture générale, dans sa forme la plus intimidante est clairement réservée aux classes dominantes. Ce n’est pas un bug, c’est une mécanique : il faut du temps dédié, des moyens et un entourage qui stimule. C’est un capital hérité, pas un terrain de jeu égalitaire.
Même si, par miracle, chacun accédait demain à ce “haut niveau culturel”, les élites déplaceraient aussitôt la ligne. Pierre Bourdieu l’a montré dans La Distinction : les classes sociales les plus favorisées définissent ce qui est considéré comme culturellement légitime — les références, les façons de parler, les goûts et dégoûts autorisés. Mais dès que d’autres groupes sociaux comment à s’approprier ces repères, elles en adoptent de nouveaux pour garder leur avance. La culture n’est donc pas un socle stable à rattraper : c’est un marqueur social en mouvement, conçu pour maintenir la plèbe à l’écart. [13].
Alors pourquoi se cultiver ?
Parce qu’il y a une culture générale indispensable pour naviguer sereinement en société. On parle ici des bases nécessaires pour comprendre les sujets de conversation et pouvoir y participer. Cette culture-là permet aussi de décoder les discours politiques, d’anticiper ou dédramatiser des événements, mais aussi saisir ce que ressentent les autres. La culture générale ne rend pas supérieur : elle rend plus libre.
Surtout, c’est une joie active, une addiction saine. Le plaisir de creuser un concept, le frisson de comprendre un texte, de relier deux événements historiques. Le sentiment d’avancer, de s’augmenter, avant tout pour soi-même.
J’ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot. Honoré de Balzac, Louis Lambert
Nous devons donc nous cultiver pour nous connaître nous-même et nous accepter. Certainement pas pour montrer patte blanche ou complexer le voisin, mais pour être pleinement heureux·se, réaliser notre condition d’humain·e et de citoyen·e.
Quitte à construire notre propre parcours d’apprentissage.

Des clés pour commencer
Comment reprendre sa culture en main et l’augmenter ? Découvrez 5 règles fondamentales pour se (re)construire un joli bagage.
Sources
[1] Ministère de la Culture : Décret n° 2024-34 du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de la culture
[2] INED : Grandes écoles : 80 fois plus de chances d’admission quand on est enfant d’ancien diplômé
[3] Paris Musées : Rapport d’activité 2023
[4] Ministère de la culture : Dynamiser la circulation des collections publiques sur l’ensemble du territoire national
[5] Journal of Science Communication : Learning at the Science Museum. A study on the public’s experiences with different types of visit at the Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” in Milan, Italy
[6] Eurostat : Culture statistics – cultural participation
[7] Tribune de Fabrice Raffin dans Le Monde
[8] Simon Herber : Designing organizations for an information-rich world, in M. Grennberger, Computer, communications and the public interest
[9] Yves Citton : Pour une écologie de l’attention, Points, 2021
[10] LeMonde.fr : Pour l’enseignement supérieur et la recherche, 904 millions d’euros de coupes budgétaires
[11] Senat.fr : Baisse significative du budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
[12] LEtudiant.fr : Universités en déficit : quel sera l’impact sur les étudiants ?
[13] Le mot « plèbe » n’a rien de péjoratif ici. Dans la Rome antique, il désignait les citoyens libres qui n’étaient pas nobles — ni esclaves, ni aristocrates. La plèbe formait la majorité de la population civique, et participait activement à la vie politique.

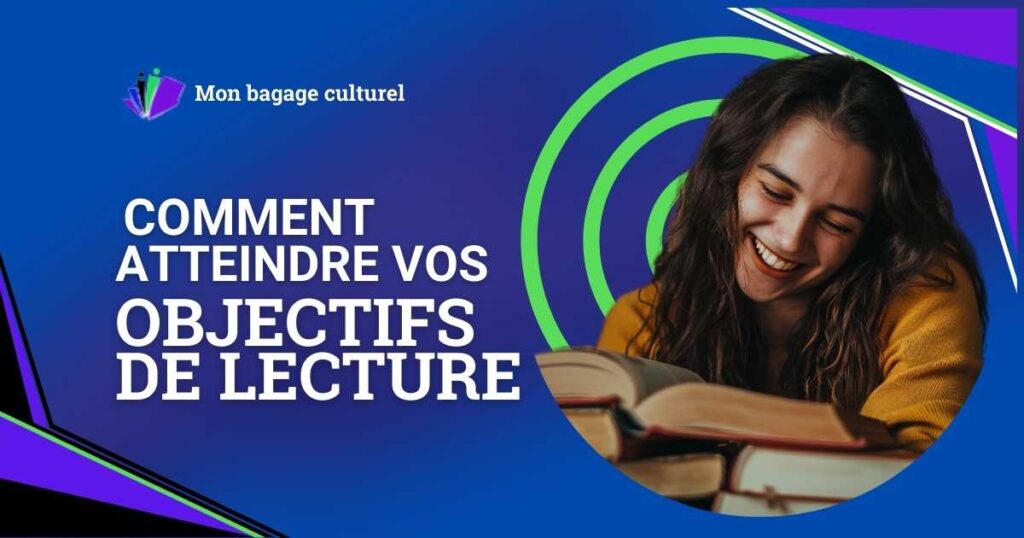
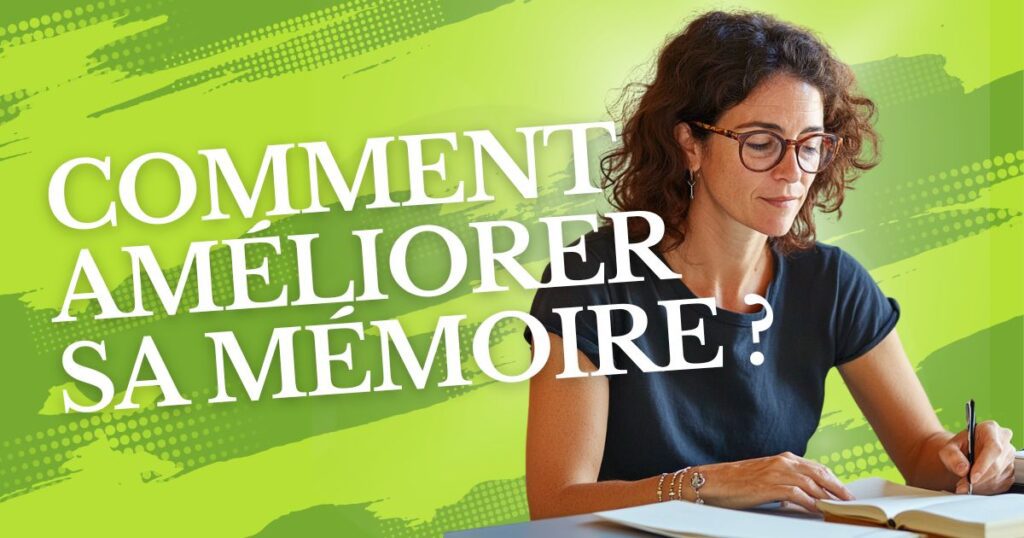
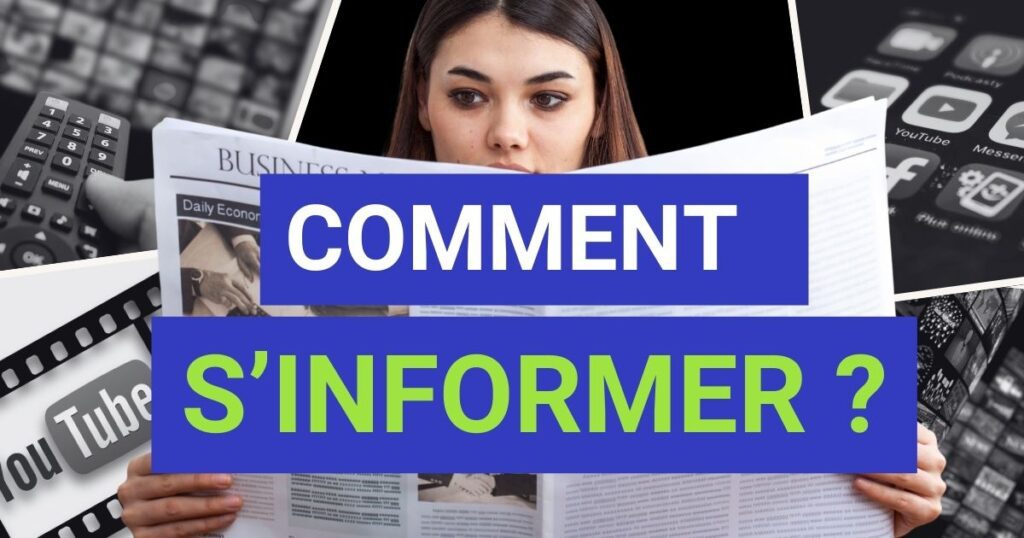
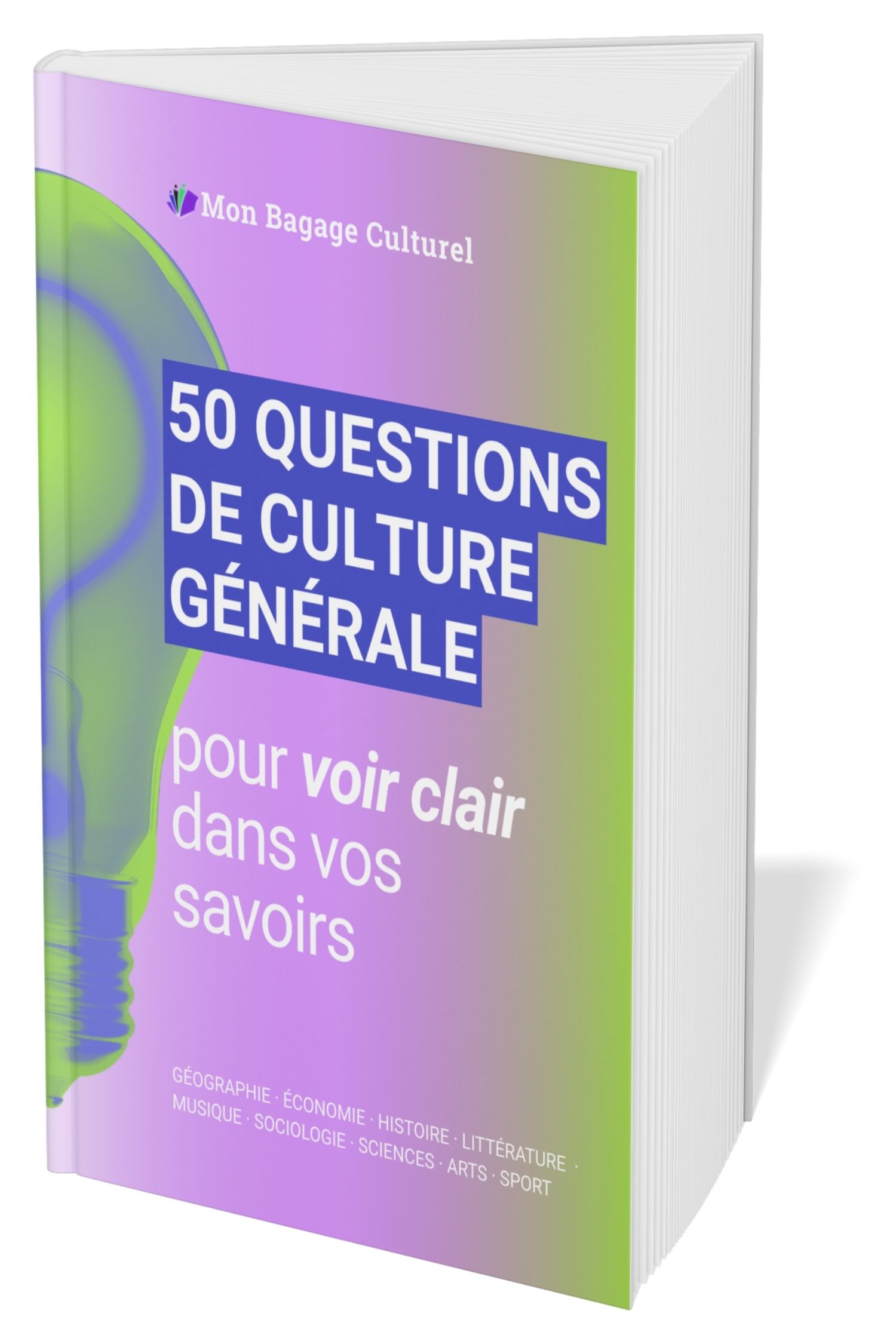
Merci pour ce très bon article, sans langue de bois. La réalité discriminatoire est malheureusement là, avec ses rares exceptions. Par exemple, l’auteur Édouard Louis a très bien expliqué les mécanismes de l’exclusion et comment il a réussi à s’en sortir grâce à la culture et aux études. Pour moi, un aspect essentiel de la culture générale est le plaisir à échanger et à créer des liens avec d’autres personnes.
Oui Alexandra, Édouard Louis est un magnifique exemple de ce que la culture peut apporter. Et, chose intéressante, il se présente lui-même comme un transfuge qui a dû se tranformer, devenir quasiment un autre pour intégrer les grandes écoles… démontrant que ce n’est pas impossible.
Tu poses des questions essentielles sur la culture d’élite, avec lucidité et intelligence. Une lecture stimulante qui pousse à réfléchir. Un vrai plaisir de te lire !
Merci Jackie, je suis heureuse de transmettre le plaisir que j’ai eu à écrire cet article 🙂
Article indispensable, à lire, relire et creuser, et qui éclaire — notamment — pourquoi et comment :
• Laurence Parisot s’est reconvertie en experte du street art
• Emmanuel Macron exhibe une Marianne street art (tiens tiens, y’a un pattern)
• Christophe Castaner, entre deux lancers de LBD et du lobbying pour Shein, publie des haïkus qu’il agrémente de photos contemplatives
• Laurent Garnier fut consacré chevalier de la Légion d’honneur (distinction habituellement réservée aux condamnés pour faits de corruption)
• les éditorialistes du Figaro se revendiquent de George Brassens
• Bolloré fait main basse sur « la culture »
↳ l’insaisissable Banksy leur pisse au cul (sauf à Laurent Garnier) et, avec lui, les innombrables anonymes qui se remettent, quotidiennement, à l’ouvrage du beau
(liste non exhaustive)
Bonjour Eva,
Je viens de découvrir ton site « Mon bagage culturel », et je dois dire que j’ai particulièrement apprécié ton article sur la culture d’élite. Il touche à des domaines qui me passionnent : la sociologie, la littérature, la transmission du savoir. C’est un sujet à la fois profond, accessible et très bien écrit, avec de belles citations et des références qui ancrent la réflexion.
Je suis enseignante en collège, et ce que tu dis sur les inégalités culturelles, je le vis au quotidien. Il existe une fracture nette entre les élèves qui ont accès à certaines références et ceux qui ne les ont pas. Je le vois très concrètement dans leur vocabulaire : certain·es utilisent des mots que d’autres ne comprennent pas, ce qui crée des malentendus, voire parfois des conflits. J’ai vu des élèves s’énerver en pensant qu’on se moquait d’eux·elles, alors qu’il s’agissait simplement d’un mot inconnu ou mal interprété.
C’est aussi flagrant dans l’humour. Certaines blagues ne fonctionnent qu’avec des références culturelles précises. Ce que certains trouvent fin ou drôle passe totalement au-dessus d’autres élèves — non pas parce qu’ils·elles manquent d’intelligence ou de sens de l’humour, mais parce qu’ils·elles n’ont pas les codes. Et je trouve cela profondément triste.
En tant qu’enseignante, j’essaie chaque jour de combler un peu ce fossé, ces différences culturelles profondément enracinées dans le milieu familial et social — comme l’a très bien montré Bourdieu. Mais ces écarts ne deviennent pas visibles seulement à 11 ou 15 ans, l’âge de mes élèves : ils sont déjà très nets dès la maternelle. Même chez des enfants qui ne savent pas encore lire, on observe des différences importantes de vocabulaire, de familiarité avec les livres, avec les récits. Et plus le temps passe, plus ces écarts se creusent.
Pendant longtemps, comme toi, je travaillais la culture générale pour les autres. Venant d’une famille modeste, je faisais déjà, dès le collège, des fiches de lecture pour enrichir mon bagage. Depuis plusieurs mois, j’ai commencé à tenir un petit carnet d’anecdotes : j’y note des choses que j’ai vécues, des situations marquantes, ou encore des choses apprises récemment. Dernièrement, par exemple, après avoir regardé un documentaire sur l’Égypte pharaonique et les Kouftis. Cela m’aide à mieux transmettre, de manière plus vivante, plus fluide. Mais oui, c’est un travail constant.
Ton article met des mots justes sur une réalité que je vis chaque jour. Il ne s’agit pas de culpabiliser, mais de prendre conscience des mécanismes en jeu pour mieux les combattre. Et je trouve cela salutaire.
Merci encore pour ton travail, que je vais suivre avec grand intérêt.
Bonjour Lison, je suis d’autant plus profondément touchée par ton commentaire que j’ai grand plaisir à naviguer dans ton blog – il est urgent qu’un maximum de personnes et de groupes développent une intelligence émotionnelle capable d’apporter un peu de paix, de recul…
Et je suis peinée de lire que l’écart culturel commence dès la maternelle, ce qui prouve que l’école de Jules Ferry fait désormais partie de l’Histoire.
Le carnet d’anecdotes ou de culture est un outil puissant, certainement plus efficace que les fiches bristol d’antan. Je pense aussi que structurer l’abondance de connaisssances en ligne et à la TV sur un support physique avec l’écriture manuscrite est l’une des clés de notre développement culturel aujourd’hui.
@CERTALDO : pourvu que rien n’empêche les créateurs de « se remettre quotidiennement à l’ouvrage du beau », indépendamment des labels qu’on leur met dessus !
Hello, tu connais Franck Lepage ?
Dans une de ses conférences gesticulées, je ne saurais pas dire laquelle, il raconte ça de façon très drôle.
Je pense qu’il en parle même dans plusieurs conférences, mais je ne me souviens pas bien.
Coucou Valheyrie, je ne suis pas forcément fan de tout ce que fait Franck Lepage, mais tu as raison, il parle énormément du mécanisme de reproduction sociale qui favorise les élites. Ça parfaitement à la problématique 🎯
Je savais bien que j’étais déjà passée par ici. 🙂 :p
Hahaha, reviens quand tu veux 😃
Tu mets le doigt avec justesse sur cette quête d’égalité des chances pour nos jeunes, dans leur parcours culturel et social.
Tant de domaines demeurent encore, à demi-mot, réservés à une certaine élite, comme des terres closes aux pas des rêveurs.
Même si des efforts sont faits, la discrimination persiste, subtile mais bien réelle, comme un murmure de rejet.
On ne peut ignorer l’ombre de cette élite qui, sous couvert de mérites, érige des barrières pour se préserver des classes dites « inférieures ».
Ton regard éclaire ce fossé, et nous invite à croire qu’un autre avenir est possible. 🤔
La Poésie Au Pouvoir ! Merci Pascal, pour tes métaphores éloquentes et suggestives qui ajoutent un halo esthétique qui apaise une réalité bien rugueuse. Et, oui, les rêveurs mériteraient d’accéder à certains domaines confidentiels… on verrait naître une nouvelle Renaissance !
Ton remarquable article est pour l’enseignant que je suis une véritable révélation (vraiment!) Je suis troublé par ta citation de Luc Ferry qui bouscule nos habitudes -et la tendance- , ainsi que par la notion de « violence symbolique » dont parle Bourdieu. Dès que j’ai fini de rédiger ce commentaire, je le relis !
Avec plaisir, Denis ! Et si ta relecture t’inspire de nouvelles pensées, n’hésite pas ! Je suis toujours preneuse des angles inattendus que tu prends.
Tout d’abord, bravo pour cet article captivant ! Au delà de son contenu philosophique, ce qui me frappe, c’est ton approche « d’autodidacte en culture G ». Alors là, respect ! On imagine trop souvent que la culture générale est acquise -ou pas- de façon définitive à la fin des études, mais tu viens bousculer cette illusion : c’est un travail de toute une vie, qui apporte chaque jour son lot de récompenses !
Merci La Rousse 😊 Oui, la culture est souvent davantage une entreprise personnelle que d’éducation. Une exception : ceux qui ont retenu tous leurs cours, du primaire à la Fac, grâce à une mémoire plus ou moins eidétique. Mais pour le commun des gens, je cite souvent Malraux qui disait : « La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert ». D
La culture générale, c’est vraiment une richesse. De mon côté, j’écoute souvent des livres audio pendant que je fais du sport ou que je cuisine. C’est hyper pratique pour apprendre sans devoir bloquer du temps juste pour ça.
Merci Jessica, pour ton commentaire, et pour la suggestion. Depuis que j’écoute des masterclasses et autres podcasts pendant mes tâches quotidiennes, je néglige les contenus culturels. Je vais alterner !
Je viens d’un milieu modeste et avec mes résultats scolaires, j’avais réussi, à l’époque, à intégrer un très (très) bon lycée par double admission sur dossier, puis sur examens écrits et oraux.
Mais j’ai assez rapidement déchanté quand je suis passée de mes excellents résultats à 5 ou 7 de moyenne dans plusieurs matières, dont le français, matière que j’appréciais tout particulièrement…
Force était de constater que mon environnement était bien différent de celui de tous les enfants d’ambassadeurs qu’étaient mes camarades de classe.
J’ai travaillé d’arrache-pied pour combler mes lacunes, et aujourd’hui je ne le regrette pas un instant. J’ai pris goût au théâtre et à l’opéra – activités impensables avec mes parents -, je suis capable de parler de beaucoup d’oeuvres littéraires, j’aime flâner dans les musées et j’apprécie plusieurs types d’expressions artistiques.
Je pense que je n’ai jamais mis les pieds dans un musée étant enfant, si ce n’est à une sortie scolaire.
Et je me sens tellement plus libre aujourd’hui !
Merci Origami Mama, pour ce témoignage bouleversant et, surtout, profondément encourageant 🙏. Tes mots illustrent clairement ce que j’essayais de dire : oui, le chemin pour augmenter sa culture (s’augmenter soi) est semé d’obstacles, oui, les écarts de niveau sont vertigineux… mais le travail, la curiosité et la persévérance finissent par payer.
Et le pas gagné, d’une culture vivante rend effectivement libre !