"La culture ne s'hérite pas. Elle se conquiert." — Je suis ravie de vous accueillir sur Mon Bagage Culturel ! Pour commencer, téléchargez votre test : 50 questions pour faire le point sur vos savoirs 🙂
Heureuse de vous revoir sur Mon Bagage Culturel ! Et si vous faisiez le point sur votre culture générale ? Je vous propose un test de 50 questions, pour repérer où vous en êtes… et identifier les prochaines étapes 🔥. Téléchargez-le ici, c’est gratuit:)
L’Union européenne, c’est 27 pays qui prennent des décisions dans les intérêts de 450 millions de citoyens sur des sujets aussi variés que l’économie, l’environnement, la politique commerciale et maintenant la défense. Son fonctionnement prévoit un équilibre entre les institutions européennes et la souveraineté des États membres, mais il n’est pas facile de savoir qui décide quoi.
Or, la connaisance du fonctionnement de l’Europe fait partie du bagage culturel de l’honnête homme/femme du 21ème siècle. Si vous deviez ne retenir que 4 institutions-clés pour comprendre le fonctionnement de l’Europe, il s’agit de celles-là :
➡️ La Commission européenne propose les lois et surveille leur application.
➡️ Le Parlement européen vote les lois et contrôle la Commission.
➡️ Le Conseil de l’Union européenne (ou simplement le Conseil) réunit régulièrement les ministres des Étas membres, et adopte les lois en tandem avec le Parlement.
➡️ Le Conseil européen regroupe les chefs d’État et de gouvernement définissent les grandes orientations politiques.
Qui chapeaute l’ensemble et fixe les grandes orientations?
Le Conseil européen se trouve au sommet de cette organisation. Il rassemble les dirigeants des 27 pays, à savoir :
- les chefs d’État (Président de la république, Roi, Grand-duc, Président fédéral…)
- ou les chefs de gouvernement (Premier ministre, Chancelier, Président du gouvernement…)
Le Conseil européen fixe les priorités de l’UE et arbitre les décisions en cas de blocage. Il désigne le président de la Commission européenne (qui doit ensuite être validé par le Parlement). Il nomme aussi le Haut Représentant pour la politique étrangère et le président de la Banque centrale européenne.
Le Conseil européen se réunit au moins quatre fois par an et son président est élu pour deux ans et demi.
Fonctionnement de l’Europe au niveau législatif : comment sont votées les lois?
L’Union dispose d’un appareil législatif qui repose sur ce qu’on appelle couramment le « Triangle institutionnel de l’UE » : le Parlement, la Commission européenne et le Conseil (de l’UE)
Le Parlement européen
Le Parlement européen est la seule institution élue directement par les citoyens. Il est composé d’un maximum de 751 députés (750 + 1 président), répartis selon un principe de proportionnalité dégressive : les petits pays sont mieux représentés que les grands. Chaque État a au moins six députés et au maximum 96. En 2024-2029, la France compte 81 députés, l’Allemagne occupe 96 des 720 sièges occupés.
Les députés siègent par groupes politiques et non par pays. Parmi les principales forces politiques, on trouve le Parti populaire européen, le Parti socialiste européen ou encore le Parti vert européen. Chaque mois (sauf en août), ils se réunissent en session plénière à Strasbourg pour voter les lois et discuter des grands enjeux.
Le président du Parlement est élu pour deux ans et demi et représente l’institution lors des négociations avec les autres instances.
La Commission européenne
Au sein de l’UE, La Commission européenne est la seule à pouvoir proposer des lois. Elle est composée de 27 commissaires, un par État membre, chacun chargé d’un domaine spécifique (environnement, commerce, santé, etc.). Le président de la Commission répartit les responsabilités et veille à la mise en œuvre des politiques européennes.
En plus de son rôle législatif, la Commission gère les politiques économiques de l’Union, notamment en matière de concurrence et de commerce international.
Le Conseil de l’Union européenne

Le Conseil de l’Union européenne (ou « Le Conseil ») réunit les ministres des États membres, qui votent les lois avec le Parlement et décident des budgets. C’est la voix des États membres. Chaque pays y est représenté par un ministre compétent selon le sujet abordé (économie, agriculture, affaires étrangères…).
Le Conseil de l’Union européenne et le Parlement doivent s’accorder sur chaque loi pour qu’elle soit adoptée.
Concernant le budget, la Commission européenne propose un projet, que le Conseil examine et amende avant de l’envoyer au Parlement. Ce dernier peut l’accepter, le modifier ou le rejeter. En cas de désaccord, des négociations ont lieu pour aboutir à une version commune.
La présidence du Conseil change tous les six mois, assurée à tour de rôle par un pays membre. À l’exception du Conseil des affaires étrangères, qui est présidé en permanence par le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères, les autres formations suivent ce système de rotation.
Comment l’Europe gère-t-elle son économie ?

L’Union dispose d’institutions chargées de la politique monétaire et budgétaire.20
La BCE est l’institution centrale de l’Union économique et monétaire. Depuis 1999, elle est responsable de la politique monétaire de la zone euro, avec un objectif principal : assurer la stabilité des prix pour éviter l’inflation excessive ou la déflation.
Elle travaille en lien avec les banques centrales nationales des États membres au sein du Système européen de banques centrales (SEBC). Ce système garantit une économie de marché ouverte et une concurrence libre, tout en veillant à des finances publiques saines.
La BCE joue également un rôle clé dans la gestion des devises : elle détient et administre les réserves officielles de change des États membres et est la seule habilitée à autoriser l’émission de billets en euros. Quant aux pièces en euros, les États membres peuvent en frapper, mais uniquement avec son approbation.
Enfin, elle produit chaque année un rapport sur la politique monétaire, présenté au Parlement européen, qui peut ensuite adopter une résolution sur ce document.
Cette institution est chargée de vérifier comment l’argent de l’Union européenne est dépensé. Composée de 27 membres, un par État membre, elle est indépendante et examine toutes les recettes et dépenses des institutions européennes et des organismes créés par l’UE.
Son rôle ne se limite pas à détecter d’éventuelles fraudes : elle s’assure aussi que les fonds européens sont utilisés de manière efficace et conforme aux objectifs fixés. Ses contrôles s’étendent aussi aux bénéficiaires finaux des fonds de l’UE, comme les États membres, les entreprises ou les organisations qui reçoivent des subventions.
Après chaque audit, la Cour publie plusieurs types de documents :
- Des rapports annuels, qui évaluent la gestion du budget de l’UE.
- Des rapports spéciaux, qui approfondissent des sujets spécifiques comme l’efficacité des programmes européens.
- Des analyses et avis, qui permettent d’orienter les politiques budgétaires de l’Union.
Qui garantit le respect des règles ?
L’Union européenne dispose de son propre système judiciaire, chargé d’interpréter et d’appliquer le droit européen.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Elle veille à l’application uniforme des lois européennes dans tous les États membres. Elle est composée de 27 juges, un par pays, et de 11 avocats généraux qui assistent la Cour.
La CJUE intervient lorsque des conflits apparaissent entre les institutions européennes et les États, ou entre les États eux-mêmes. Elle peut être saisie par les tribunaux nationaux pour trancher des questions de droit européen.
Le Tribunal, rattaché à la CJUE, traite des litiges plus spécifiques, notamment liés aux droits de propriété intellectuelle ou aux décisions économiques de la Commission.
Quelle place pour les citoyens ?
Les citoyens européens ont plusieurs moyens d’influencer les décisions :
- Élections européennes : tous les cinq ans, ils élisent leurs députés au Parlement européen.
- Initiative citoyenne européenne : si un million de citoyens issus d’au moins un quart des États membres se mobilisent sur un sujet, la Commission doit examiner leur demande et organiser un débat au Parlement.
- Contrôle national : les parlements des États membres reçoivent les projets de loi européens et peuvent donner leur avis.
Le fonctionnement de l’Europe : des succès, des blocages, des compromis
L’Union européenne repose sur un équilibre délicat entre les institutions et les États membres. L’idée de départ est claire : agir ensemble là où c’est plus efficace que de le faire séparément.
Dans de nombreux domaines, cela fonctionne. Le marché unique facilite les échanges, l’euro apporte une stabilité économique, et l’UE pèse dans les grandes négociations internationales. Mais le système a ses limites. Les décisions prennent du temps, les États membres sont divisés sur de nombreuses questions, et certains jugent que l’Europe intervient trop ou pas assez selon les sujets.
Nous avons tous remarqué que cette tension se retrouve à chaque crise. Qu’il s’agisse de politique énergétique, de gestion des frontières ou de défense, l’Union se trouve souvent acculée à des compromis entre des intérêts divergents. Or, les défis globaux – climatiques, économiques, géopolitiques – réclament des réponses (de plus en plus) rapides et coordonnées.
L’UE doit donc continuellement ajuster son fonctionnement pour rester efficace sans renier son principe fondateur : unir des États souverains autour de décisions communes. D’où la question qui fâche : faut-il plus d’Europe ou moins d’Europe pour mieux gérer les crises ? Qu’en pensez-vous ?



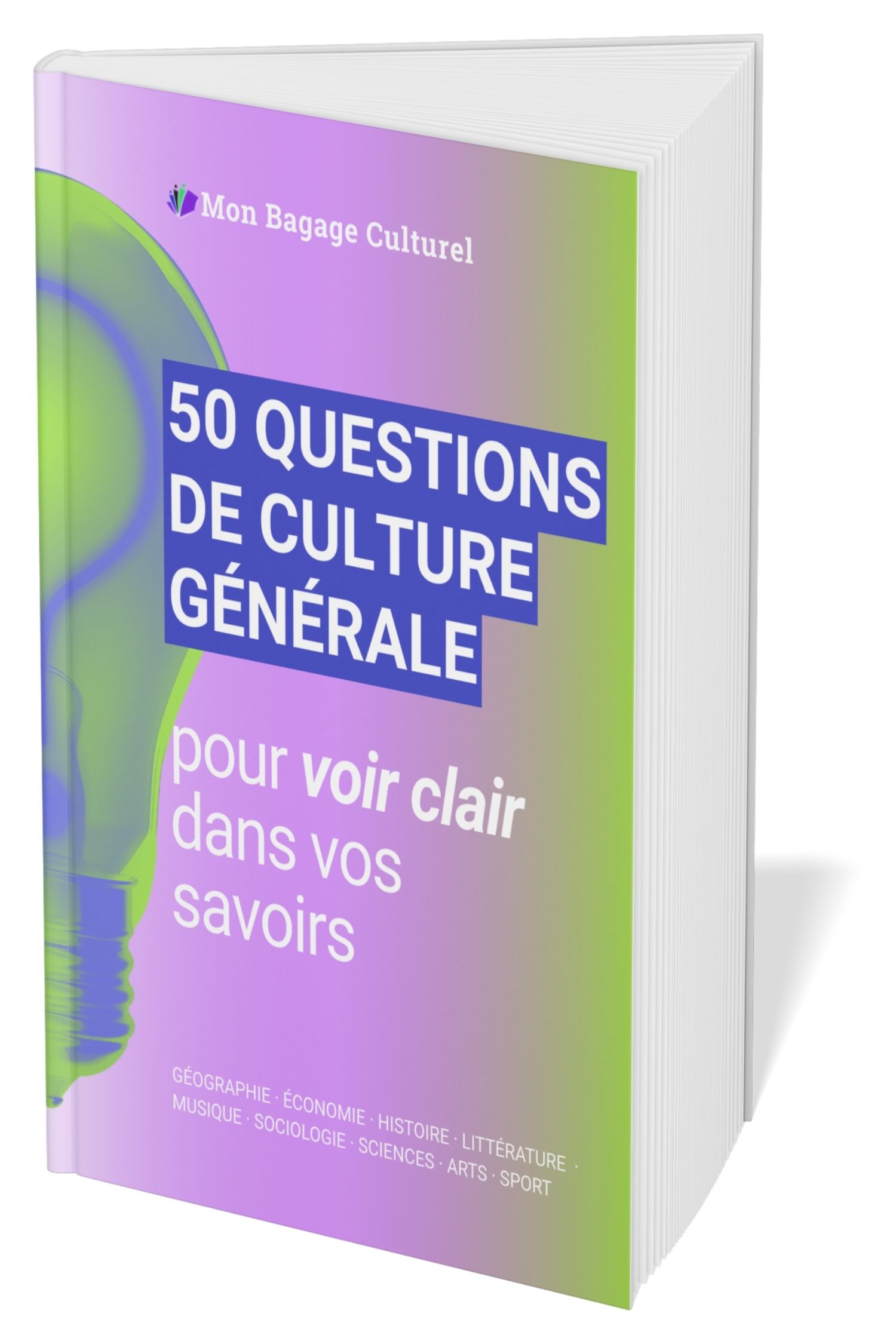
Merci pour cet article clair sur le fonctionnement de l’UE. Comprendre ces mécanismes est essentiel, surtout face aux défis actuels.
L’actualité 2025 illustre bien cela, avec des décisions majeures sur la défense et le soutien économique. L’UE continue d’évoluer pour répondre aux enjeux géopolitiques et sociaux.
Merci pour ton commentaire, Jean ! Tu as raison, cette institution unique en son genre et à la pointe sur de nombreux sujets, continue de s’adapter aux enjeux de plus en plus pressants
Merci beaucoup pour cet article qui rappelle l’importance du fonctionnement politique de l’Europe.
Son influence est omniprésente dans notre quotidien (qui n’a pas râlé avec les bouchons plastiques accrochés à leurs bouteilles 😉) et pourtant, on voit le peu d’intérêt des gens au moment des élections.
Alors la réponse est peut être une Europe différente.
Très juste, Ketty, l’Europe a du chemin à faire pour gagner en cohérence, en transparence et en lisibilité, seul moyen peut-être pour intéresser les citoyens…
Ton article sur le fonctionnement de l’Union Européenne est très clair et informatif. J’aime beaucoup comment tu expliques les rôles de chaque institution clé, comme la Commission, le Parlement et le Conseil, ainsi que leur interaction dans le processus législatif. C’est un excellent guide pour mieux comprendre l’UE et son système décisionnel, surtout pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces structures 🙂
Merci beaucoup Rémi !
Merci pour ce contenu très détaillé et très intéressant. Il est bon de rappeler comment nous sommes censés fonctionner au niveau européen et comprendre les difficultés d’alignement qu’il faut surmonter.
Avec plaisir, Sophie ! Un fonctionnement très complexe effectivement, j’ai volontairement passé sous silence les détails sur l’organisation et les différents rôles, sans parler des autres institutions. C’est dire la difficulté d’y voir clair, mais aussi de faire bouger les lignes 🙂
Merci pour ton article clair et complet ! Au vu du contexte actuel, où notre belle Europe a plus que jamais besoin d’être unie face aux défis qui l’attendent et à la barbarie qui la menace, il est fondamental de comprendre les rouages (finalement assez simples) de l’institution. Puisse l’Ukraine libérée nous rejoindre un jour prochain !
Exactement, Denis, et il est urgent de vulgariser aussi les atouts et les beautés de l’UE ! Merci d’être passé 🙂
Entre Conseil , Parlement, Commission, on se mélange souvent un peu, même si l’on sait qu’il est toujours question d’Europe. Ton article très clair et complet nous permet de bien situer qui fait quoi. Et dans l’époque troublée que nous traversons, c’est indispensable. Un grand merci pour la clarté de tes explications !
Mille mercis pour ton commentaire ! Si je suis arrivée à débroussailler les différents noms je peux m’estimer satisfaite ! La différence entre Conseil (des ministres) de l’UE et le Conseil européen par exemple est aussi intuitive que le paradoxe de Simpson !
Article super clair et synthétique ! Pas facile d’expliquer le fonctionnement de l’UE sans se perdre dans les détails, et tu as relevé ce défi haut la main: merci !
La question des tensions entre coopération et souveraineté restent en effet au cœur des débats sur l’avenir de l’Europe. Et la rapidité de décision est donc un vrai enjeu face aux crises. Merci pour ce partage éclairant.
Merci Line, venant de la reine de la démystification des maths, cette appréciation me touche !